CAPES de Lettres Modernes
|
CONFIANCE, PERSÉVÉRANCE et RÉUSSITE !
Au nom du Professeur Christian Morzewski, Président de l’université
d’Artois, de l’ensemble de mes collègues et de toute l’équipe
administrative, je vous souhaite la bienvenue à l’Unité de Formation et de
Recherche de Lettres & Arts.
Les concours d’enseignement (CAPES et Agrégation) constituent pour bon
nombre d’étudiants littéraires l’aboutissement de leur cursus
universitaire et l’accomplissement d’une vocation, parfois nourrie de
longue date !
Nous sommes heureux de proposer à l’université d’Artois une préparation
au CAPES externe de Lettres Modernes (et à l’Agrégation interne) dont les
résultats récompensent chaque année les efforts de chacun. À la derrière
session, le taux de réussite fut près de 40 % pour les étudiants
arrageois.
Ce guide 2007-2008 rassemble tous les renseignements administratifs
relatifs au concours et l’ensemble des bibliographies nécessaires à une
préparation efficace, notamment pour l’ancien français qui fait l’objet
d’un programme spécifique. Il renferme également les annales des épreuves
écrites de la session 2007.
À côté des révisions personnelles, le travail en petit groupe (en duo
par exemple) est vivement conseillé ainsi que l’entraînement hebdomadaire
aux exercices écrits et oraux. Le CAPES blanc de janvier est un
rendez-vous à ne pas manquer.
Notre unique souhait est votre réussite. Tout au long de l’année
universitaire, les enseignants intervenant en CAPES et le secrétariat de
l’UFR demeurent à votre disposition pour vous renseigner, vous conseiller
et vous encourager.
Tous nos voeux vous accompagnent en cette année pleine de
promesses ! Jean-Marc Vercruysse
responsable pédagogique de la
préparation
P.S. : Si vous envisagez de préparer
conjointement le Master « Lettres, Langues et Arts », un autre
guide réunit les programmes des deux années dont les séminaires et les
axes de recherche sont communs à l’UFR de Lettres & Arts et à l’UFR de
Langues Étrangères.
LES
ÉPREUVES DU CONCOURS
TEXTES DE RÉFÉRENCE
cf. B.O. n° 8 du 24 février 1994 et B.O. spécial n° 3 du 17 mai 2007.
a) Épreuves écrites d'admissibilité
1.
Composition française (durée 6 heures, coeff. 6).
2.
Étude grammaticale et stylistique de deux textes français, l'un
antérieur à 1500 sur programme, l'autre postérieur à 1500, pris dans les
auteurs figurant au programme de l'enseignement du second degré
(durée 5 heures - 2h 30 pour chaque partie de l'épreuve - coeff . total 4).
3.
Version dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat
formulé lors de son inscription : latin, grec, allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, polonais,
portugais, roumain, russe, tchèque (durée 4 heures, coeff. 2). L'usage d'un
dictionnaire est fixé par une note publiée au
Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale.
b) Épreuves orales d'admission
1.
Explication française
suivie d'un entretien avec le jury (durée de la préparation : 2
heures ; durée de l'interrogation : 1h, soit 30 mn d'explication et 30 mn
d'entretien dont 10 mn d'exposé du candidat sur une question de grammaire,
coeff. 5). Pas de programme sauf celui des classes de français des collèges
et lycées - c'est-à-dire, toute la littérature française du XVI
e au XX
e siècle !
2.
Commentaire d'un texte dans l'une des langues suivantes, au choix
du candidat formulé lors de son inscription : latin, grec, allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, polonais,
portugais, roumain, russe, tchèque
(durée de la préparation : une heure, durée de l'interrogation 30 minutes,
coeff. 2).
3.
Épreuve orale sur dossier : cette épreuve comporte un exposé suivi
d'un entretien avec les membres du jury. Elle prend appui sur des
documents proposés par le jury. Elle permet au candidat de démontrer :
- qu'il connaît les contenus d'enseignement et les programmes de la
discipline au collège et au lycée,
- qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la discipline ainsi
que sur les relations de celle-ci aux autres disciplines,
- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse
et à la communication,
- qu'il peut faire état de connaissances élémentaires sur l'organisation
d'un établissement scolaire du second degré.
(durée de la préparation : 2 heures, durée de l'épreuve : 1h maximum
: exposé 30 mn maximum et entretien : 30 mn, coeff. 5).
UN GUIDE GÉNÉRAL ET LES RAPPORTS DE JURY -
CAPES de Lettres Modernes. Concours externe. Sujets, corrigés, conseils
de méthode, ouvrage dirigé par Laurent Fourcaut, 1998, édition
Vuibert, coll. « Annales des concours »
« bible » complète du CAPES de Lettres Modernes, en 500 pages bourrées de
renseignements pratiques sur le concours : méthodes et conseils de
préparation, présentation générale des épreuves écrites et orales - sauf
allemand - pour chacune des matières, avec annales corrigées. L'épreuve
orale sur dossier occupe près de 200 pages de cet ouvrage particulièrement
précieux pour des candidats qui ne pourraient pas suivre la préparation à
l’I.U.F.M. et à l’Université. - Il est vivement conseillé de
consulter les rapports du jury, maintenant disponibles sur Internet. Pour
la session 2006 :
« http://www.education.gouv.fr/siac/siac2/jury/2006/detail/capes_ext_letrmod.htm » - N’hésitez pas à consulter
également les pages intitulées « Se former pour être professeur des
Lycées-Collèges » sur le site de l’IUFM :
« www.lille.iufm.fr ».
LA PRÉPARATION À L'UFR DE LETTRES & ARTS La prérentrée aura lieu le mardi 11 septembre 2007 à
9h, en salle ‘Louise Labé’ (LM 1). En 2007-2008, la préparation
aux épreuves écrites et orales du CAPES de Lettres Modernes est organisée
le mardi (toute la journée) et le jeudi (toute la journée). Le vendredi
matin est traditionnellement réservé à l’entraînement en temps limité et
un certain nombre de lundi est consacré à la préparation de l’Épreuve
Orale sur Dossier dispensée à l’IUFM. La préparation débutera le
mardi 11 septembre (après-midi) :
1.
Entraînement à la composition française : cours de 3h / semaine.
2.
Entraînement à l'étude grammaticale et stylistique :
- texte antérieur à 1500 : 1 cours de 2h 30 / semaine.
- texte postérieur à 1500 : 2 cours de 1h 30 / semaine (soit 3 heures).
3.
Entraînement à la version et au commentaire oral en langue vivante
étrangère (anglais, allemand ou espagnol)
ou langue ancienne (latin) : cours de 1h à 2h / semaine.
4.
Entraînement à l'explication française : cours de 2h / semaine.
5.
Devoirs sur tables et « CAPES blanc ».
Pour les différentes épreuves écrites, des devoirs sur table seront
régulièrement organisés le vendredi dans les conditions du concours. Un
« CAPES blanc » est également prévu dans la semaine du 7 janvier
2008.
6.
Entraînement à l’oral
En plus des séances hebdomadaires programmées de septembre à mars,
l'entraînement aux épreuves orales (explication française + commentaire en
latin ou L.V.) sera intensivement renforcé après les épreuves écrites du
CAPES et après la semaine de stage I.U.F.M. ("colles" collectives et
"colles" individuelles de début avril à mi-juin). --> Les épreuves écrites
auront lieu entre le 4 et le 19 mars 2008, et les épreuves orales
d’admission de mi-juin à début juillet. Les résultats définitifs sont
habituellement publiés autour du 14 juillet (cf. calendrier p. 6).
LES INSCRIPTIONS Comme tout concours de la fonction publique,
le CAPES peut être passé librement par toute personne possédant les titres
requis (en l’occurrence le grade de Licence) et inscrite au concours.
Toutefois, il est recommandé de suivre la
préparation complète qui en est assurée conjointement par l'Université et
par l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) et qui repose
sur trois inscriptions distinctes et successives : 1)
L’Inscription à l’IUFM
est conditionnée par un dossier de demande
d'admission (à la suite d’une préinscription entre le 4 juin et le 6
juillet sur le serveur « www.lille.iufm.fr »)
et par l’obtention du diplôme de Licence. L’IUFM convoque les candidats pour confirmer
leur inscription fin août-début septembre : IUFM Nord – Pas-de-Calais
365 bis rue Jules Guesde
BP 50458
59658 Villeneuve d’Ascq cedex
Il convient de prendre contact de toute
urgence avec le service d'inscription si un dossier de demande d'admission
n’a pas été déposé dans les délais prescrits (tél. : 03 20 79 86 74). En s’inscrivant à l’I.U.F.M., l’étudiant est
automatiquement inscrit à l'université de rattachement qu’il désigne
(l'université d’Artois à Arras pour la préparation au CAPES de Lettres
Modernes, par exemple). L’I.U.F.M. gérera pour lui cette inscription
qui le rendra étudiant de plein droit de l'université considérée. Il n’y
aura aucune démarche administrative personnelle à effectuer à
l'université, ni de frais d'inscription supplémentaire à acquitter, sauf
si le candidat décide de préparer parallèlement un Master. 2)
l’inscription « pédagogique » L’inscription pédagogique à la préparation
universitaire aura lieu à Arras, à l'U.F.R. de Lettres & Arts, le
mardi
11 septembre 2007 à 9h, en salle ‘Louise Labé’ (LM 1). Cette inscription est obligatoire pour
pouvoir suivre les enseignements à l'université d’Artois. 3)
l’inscription « administrative » (cf. J.O. 18 avril 2007) C’est la plus importante des
trois inscriptions. Une adresse électronique
personnelle est indispensable. N’attendez pas les derniers jours pour vous
connecter ! Pour la session 2007,
l’inscription administrative au concours doit être effectuée entre le
jeudi 13 septembre (à partir de 12h) et le mardi 23 octobre (avant 17h)
sur le site internet du Ministère de l’Éducation Nationale :
« www.education.gouv.fr/siac/siac2 » Il faudra confirmer cette
inscription entre le mardi 30 octobre (à partir de 12h) et le mardi 13
novembre (avant 17h) toujours par internet.
L’attention des étudiants
préparationnaires est attirée sur l’importance capitale de cette
inscription qui constitue un acte personnel conditionnant totalement la
possibilité de passer les épreuves du concours.
BIBLIOGRAPHIES
- COMPOSITION FRANÇAISE - Enseignants : Marianne CLOSSON (théâtre),
Francis MARCOIN (roman) et Barbara BOHAC (poésie) Bibliographie : Un guide général pour le
concours :
Capes de Lettres Modernes. Concours externe. Sujets, corrigés, conseils
de méthode, L. Fourcault (dir.), Vuibert, 1998. A. Manuels de méthodologie de la dissertation
- A. Chassang et C.
Senninger,
La Dissertation littéraire générale, 3 vol., Hachette, 1992
(rééd.).
- A. Chassang et C.
Senninger,
Les Textes littéraires généraux, Hachette, 1992 (rééd.).
- Y. Baudelle (dir.),
Dissertations littéraires générales, Nathan, 1995.
- H. Merlin,
La Dissertation littéraire, Seuil, « Mémo », 1996. B. Bibliographie littéraire Ouvrages généraux 1. Une bonne anthologie par
siècles (par exemple
Littérature. Textes et documents, Nathan « collection Henri
Mitterand », 1988, ou
Itinéraires littéraires, Hatier, 1991).
2. Une histoire de la
littérature française (par exemple les trois volumes
Poésie, Théâtre, Roman, Bréal, 1996-1999). Voir aussi la collection
« Amphi Lettres », Bréal (par genre/siècle).
3. Un bon dictionnaire de la
littérature :
Dictionnaire des littératures de langue française (Bordas, 1984),
Dictionnaire du littéraire (PUF, 2002).
4. Ouvrages de base sur les
catégories littéraires :
Littérature : textes théoriques et critiques, Nathan
Université, 2004.
Introduction aux méthodes critiques pour l’analyse littéraire,
Bordas, 1990.
- J.-M.
Adam,
Les Textes : types et prototypes. Récit, description,
argumentation, explication et dialogue, Nathan, 1992.
- R.
Barthes,
Le Plaisir du texte, Seuil, 1973.
- D.
Combe,
Les Genres littéraires, Hachette, 1992.
- U. Eco,
Interprétation et surinterprétation, PUF, 1996.
- G.
Genette,
Introduction à l’architexte [1979] ;
Fiction et diction [1991], Seuil, « Points », 2004 ;
Figures (Seuil, 1972-1999).
- N.
Piégay-Gros,
Introduction à l’intertextualité, Nathan Université, 2002.
- F.
Monneyron et J. Thomas,
Mythes et littérature, Puf, « Que sais-je ? », 2002.
- J.-M.
Schaeffer,
Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Seuil, 1989.
- J.-P.
Sartre,
Qu'est-ce que la littérature ?, Gallimard, 1948.
- P.
Soler,
Genres, formes, tons, Puf, 2001.
- T.
Todorov,
Les Genres du discours, Seuil, 1978. Voir
également : la
collection « Corpus » (GF Flammarion), notamment
L’Auteur,
Le Lecteur,
La Fiction,
La Mimesis, Le Personnage,
Le Tragique, Le Comique…, ou « Nathan Université », ou
encore la collection « Bibliothèque Gallimard. Registres » (
Le Didactique) : ces trois collections combinent analyses et
anthologie de textes théoriques
. Sur le roman, la nouvelle
et l’autobiographie 1. Textes
Rabelais,
Gargantua et
Pantagruel (1532-1534) – Sorel,
Histoire comique de Francion (1623) - Scarron,
Le Roman comique (1651-1657) – Guilleragues,
Lettres portugaises (1669) – Madame de Lafayette,
La Princesse de Clèves (1678) – Abbé Prévost,
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut (1731) –
Voltaire,
Contes philosophiques – Marivaux,
La Vie de Marianne (1743) – Rousseau,
Julie ou La Nouvelle Héloïse (1760),
Les Confessions (1782-1789) – Diderot,
Jacques le Fataliste (1778) – Choderlos de Laclos,
Les Liaisons dangereuses (1782) – Balzac (quelques romans, pas
forcément les plus connus) – Zola,
Germinal (1885), et autres, comme pour Balzac – Stendhal,
Le Rouge et le Noir (1830),
La Chartreuse de Parme (1839) – Nerval,
Aurélia (1855) – Flaubert,
Madame Bovary (1857) et
L’Éducation sentimentale (1869) – Maupassant,
Une vie (1883),
Pierre et Jean (1888), nouvelles – Proust,
Du côté de chez Swann (1913) – Gide,
Les Faux-Monnayeurs (1926) – Breton,
Nadja (1928/1963) – Céline,
Voyage au bout de la Nuit (1932) – Malraux,
La Condition humaine (1933) – Sartre,
La Nausée (1938) – Leiris,
L’Âge d’homme (1939) – Camus,
L’Étranger (1942) – Aragon,
Aurélien (1944) – Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien (1951) – Sarraute,
Le Planétarium (1959) – Tournier,
Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967) – Perec,
W ou le souvenir d’enfance (1975) – Simon,
Les Géorgiques (1981) - Duras,
L’Amant (1984) – Quignard,
Tous les matins du monde (1991). 2. Poétique et histoire
littéraire -
Idées sur le roman, éd. H. Coulet (dir.), Larousse, « Textes
essentiels », 1992.
- P.
Chartier,
Introduction aux grandes théories du roman, Nathan, 2000.
- J. Gracq,
En lisant en écrivant, Corti, 1981.
- M.
Kundera,
L’Art du roman, Gallimard, 1986.
- P.
Lejeune,
Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975.
- T. Pavel,
L’Univers de la fiction, Seuil, « Poétique », 1988 ;
La Pensée du roman, Gallimard, 2003.
- P.-L.
Rey,
Le Roman, Hachette, 1992.
- N.
Sarraute,
L’Ère du soupçon, Gallimard, 1956. 3. Ouvrages critiques - E.
Auerbach,
Mimesis, Gallimard, 1968.
- M.
Bakhtine,
Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1975-1978.
- R.
Barthes, W. Kayser, W. Booth, P. Hamon,
Poétique du récit, Seuil, 1977.
- R.
Barthes, L. Bersani, P. Hamon, M. Riffaterre, I. Watt,
Littérature et réalité, Seuil, 1982.
- U. Eco,
L’ľuvre ouverte, Seuil, 1965 ;
Lector in fabula, Grasset, 1985.
- H.
Godard,
Poétique de Céline, Gallimard, 1985.
- J.-P.
Richard,
Stendhal. Flaubert : Littérature et sensation, Seuil, 1970.
- J.
Rousset,
Forme et signification, Corti, 1992.
- T.
Todorov,
Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970. Sur la poésie
1. Textes Marot,
L’Adolescence clémentine – Ronsard,
Odes, Les Amours, Hymnes – Du Bellay,
Les Regrets – Saint-Amant – Théophile de Viau – La Fontaine –
Boileau,
Satires – A. Chénier,
Iambes – Hugo,
Les Contemplations, Les Châtiments, La Légende des siècles –
Lamartine – Vigny – Baudelaire,
Les Fleurs du mal, Les Petits Poèmes en prose – Leconte de Lisle
, Poèmes antiques – Heredia,
Trophées – Verlaine,
Jadis et Naguère – Mallarmé – Rimbaud,
Une Saison en enfer,
Illuminations – Lautréamont – Claudel,
Cinq grandes Odes – Apollinaire,
Alcools – Breton – Eluard – Aragon – Desnos – Saint-John Perse,
Amers – Ponge,
Le Parti pris des choses – Char,
Les Matinaux,
Fureur et Mystère – Reverdy,
Le Gant de crin, En vrac – Michaux,
L’Espace du dedans – Prévert – Queneau – Bonnefoy – Jaccottet,
Pensées sous les nuages, La Promenade sous les arbres. Sans oublier que beaucoup
d’écrivains de théâtre sont aussi des poètes... 2. Poétique et histoire
littéraire -
La Poésie. Textes critiques XIVe-XXe siècle,
éd. J.-M. Gleize, Larousse, « Textes essentiels », 1995.
-
Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance, Le Livre de
poche, 1990.
- A.
Breton,
Manifestes du surréalisme, Gallimard, « Idées », 1963
(rééd.).
- P.
Claudel,
Positions et propositions sur le vers français,
Réflexions sur la Poésie (dans
ľuvres en prose, Gallimard, « La Pléiade », 1965)
.
- A.
Gendre,
Évolution du sonnet français, PUF, 1996.
- M.
Jarrety,
La Poésie française du Moyen Âge à nos jours, PUF, 1997.
- D.
Leuwers,
Introduction à la poésie moderne et contemporaine, Bordas, 1992.
- O.
Paz,
L’Arc et la Lyre, Gallimard, 1965.
- P.
Valéry,
Variétés, dans
ľuvres, Gallimard, « La Pléiade », 1957. 3. Ouvrages critiques - R.
Barthes,
Le Degré zéro de l'écriture ("Y a-t-il une écriture poétique?"),
Seuil, 1953.
- J.
Cohen,
Structure du langage poétique, Flammarion, 1966.
- J.-M.
Gleize,
Poésie et figuration, Seuil, 1983.
- R. Jakobson,
Huit questions de poétique, Seuil, 1973.
- J.-M.
Maulpoix,
La Voix d'Orphée, José Corti, 1989.
- J.-M.
Maulpoix,
La Poésie malgré tout, Mercure de France, 1996.
- H.
Meschonnic,
Pour la Poétique I, II, III, Gallimard, 1970-1978.
- G.
Mounin,
La communication poétique, Gallimard, 1969.
- J.-P.
Richard,
Poésie et profondeur, Seuil, 1955 ;
Onze étude sur la poésie moderne, Seuil, 1964.
- P.
Ricoeur,
La Métaphore vive, Seuil, 1975.
- J.
Roubaud,
La Vieillesse d’Alexandre, Ramsay, 1988.
- J.-P.
Sartre,
Situations II, "Orphée noir",Gallimard, 1949.
Sur le théâtre 1. Textes Eschyle,
Les Perses – Sophocle,
Oedipe-Roi,
Antigone – Euripide,
Hippolyte – Shakespeare,
Othello, Hamlet, Macbeth, etc. – Corneille,
L'Illusion comique,
Le Cid, Horace, Cinna, etc. – Molière,
Dom Juan, Le Misanthrope, L'École des Femmes, Les Fourberies de Scapin,
Le Malade imaginaire, etc. – Racine,
Bérénice, Iphigénie, Phèdre, etc. – Marivaux,
Le Jeu de l'amour et du hasard, L’Île des esclaves – Beaumarchais,
Le Mariage de Figaro – Hugo,
Cromwell, Hernani, Ruy Blas – Musset,
Lorenzaccio –Jarry,
Ubu roi – Claudel,
L’Annonce faite à Marie, Le Partage de midi, Le Soulier de satin –
Brecht,
Maître Puntila et son valet Matti – Giraudoux,
La Guerre de Troie n’aura pas lieu – Sartre,
Les Mouches, Huis clos – Ionesco,
La Cantatrice chauve, Rhinocéros – Federico Garcia Lorca,
Noces de sang – Beckett,
En attendant Godot, Acte sans parole – Genet,
Les Bonnes – Anouilh,
Antigone – H. Cixous – V. Novarina – B.-M. Koltès. 2. Poétique et histoire
littéraire
-
Esthétiques théâtrales, Sedes, 1982.
-
Aristote,
Poétique, Livre de Poche, 1990 (cette édition comporte une
introduction retraçant l'histoire de la réception de ce texte capital pour
l'histoire du théâtre, ainsi que les textes de Platon à connaître).
-
Artaud,
Le Théâtre et son double, Folio, « essais ».
-
Brecht,
Petit organon sur le théâtre, L'Arche.
-
Corneille,
Trois discours sur le poème dramatique, GF Flammarion, 1999.
-
Diderot,
Ecrits sur le Théâtre, I et II, Pocket, « Agora », 1995.
- Hugo,
Préface de Cromwell, GF Flammarion.
-
Nietzsche,
La Naissance de la tragédie, Le Livre de Poche.
-
Racine, Préfaces.
- J.-J.
Roubine,
Introduction aux grandes théories du théâtre, Nathan Université,
2000.
-
Stendhal,
Racine et Shakespeare, Kirné, 1996.
- G.
Steiner,
La Mort de la tragédie, Folio, « essais », 1993.
- A. Viala,
Le Théâtre en France des origines à nos jours, Puf, 1997. 3. Ouvrages critiques
- A.
Couprie,
Lire la tragédie, Dunod, « Lettres sup. », 1998.
- M. David,
Le Théâtre, Belin, 1995.
- P.
Larthomas,
Le Langage dramatique, Puf, 1980.
- J.-P.
Ryngaert,
Introduction à l’analyse du théâtre, Bordas, 1991.
- A.
Ubersfeld,
Lire le théâtre, Belin, « Sup », 3 vol. Sur la littérature
non-fictionnelle Ne pas oublier que font
partie de la littérature : - les dialogues, qui peuvent
ressortir aussi de la philosophie, de la science (Fontenelle,
Entretiens sur la pluralité des mondes), de l’histoire et de la
théorie littéraires (C. Perrault,
Parallèles des anciens et des modernes, P. Valéry), ou d’un peu
tout cela (Diderot,
Le Neveu de Rameau).
- les correspondances
(Flaubert).
- les journaux intimes (B.
Constant, Stendhal, J. Renard, J. Green).
- les mémoires (Retz,
Saint-Simon, Chateaubriand, Sartre,
Les Mots, S. de Beauvoir).
-
les « moralistes » (La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues,
Stendhal,
De l’amour, Cioran).
- certains articles de
journaux (Marivaux,
Le Spectateur français ; Zola,
J’accuse).
- certains textes religieux
(Bossuet,
Oraisons funèbres) ; historiques (Michelet,
La Sorcière) ; politiques (Montesquieu,
L’Esprit des lois) ; philosophiques (Descartes,
Discours de la méthode ; Pascal,
Les Provinciales, Les Pensées ; Voltaire,
Lettres philosophiques et
Dictionnaire philosophique ; Camus,
Le Mythe de Sisyphe).
- certains textes de critique
(littéraire, voir Aristote, Horace,
Épître aux Pisons, Boileau et Verlaine,
Art poétique, Mme de Staël,
De la littérature, Baudelaire,
De l’essence du comique, R. Barthes ; picturale, voir les
Salons de Diderot, de Baudelaire…).
- et enfin tout ce qu’on
rassemble, depuis Montaigne (à lire !), sous la catégorie des
« essais » ou « traités » (voir P. Glaudes et J.-F.
Louette,
L’Essai, Hachette supérieur, 1999).
- ÉTUDE GRAMMATICALE ET STYLISTIQUE : TEXTE ANTÉRIEUR À 1500 - enseignant : Jean-Pierre MARTIN
épreuve : L’épreuve comporte
traditionnellement cinq exercices : traduction, phonétique
historique, morphologie, syntaxe et étude de vocabulaire. Texte au
programme :
Le Roman de Renard,
première branche, édition Mario Roques, Paris, 2007, (1e éd. 1948), Champion, Classiques Français du Moyen Âge,
n° 78.
==> Le passage étudié pour cette épreuve
va du vers 1 au vers 2260. La
traduction a été assurée par Henry Rey-Flaud et André Eskénazi, et publiée
sous le même titre, Paris, Champion, 2007 (1e éd. 1971), Traductions des Classiques Français du Moyen Âge,
n° 8. On pourra la comparer à celles de Jean Dufournet et André
Méline, Garnier-Flammarion, 1985, t. I, v. 1-2204 ; et de Dominique
Boutet dans l’édition dirigée par Armand Strubel, Gallimard, Pléiade,
p. 1-60, en prenant garde qu’elles sont fondées sur des manuscrits
différents qui peuvent présenter des divergences notables avec celui
choisi par Mario Roques. N.B. : Il est vivement
recommandé d'avoir entrepris l'étude du texte avant le début des cours et
d’en avoir lu la traduction intégrale avant le début des cours.
Le texte ne comporte pas de
caractéristiques dialectales notables, et les principaux traits qui en
caractérisent la langue sont indiqués aux pages XVI-XVII de
l’introduction.
Il va de soi qu’une
connaissance des autres branches du
Roman de Renart (à commencer par la fin de la branche I)
facilitera la compréhension du passage au programme. Les deux autres
éditions mentionnées ci-dessus le permettent aisément.
LES OUVRAGES SUIVANTS SERONT D'USAGE CONSTANT.
IL EST INDISPENSABLE DE LES AVOIR TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN :
- A.-J. GREIMAS,
Dictionnaire de l'ancien français, Larousse. C’est le plus complet
des dictionnaires d’ancien français disponibles dans le commerce, mais il
vaut mieux éviter de lui vouer une confiance aveugle...
- G. JOLY,
Précis de phonétique historique du français, Colin, coll. U (oeuvre
d’un membre régulier du jury).
- G. ZINK,
Morphologie du français médiéval, PUF (un des ouvrages les plus
clairs dans ce domaine)
ou
- G. JOLY,
Précis d’ancien français, Colin, coll. U (morphologie et
syntaxe ; fait la synthèse des travaux les plus récents dans l’esprit
du concours). Pour la syntaxe, cet ouvrage vise d’abord à donner des plans
d’étude sur les principales questions envisageables. Il ne pourra pas
toutefois se substituer à l’un des deux suivants :
- Ph. MÉNARD,
Syntaxe de l'ancien français, Bordeaux, Bière, de préférence à
partir de la 3e édition (1988)
- et/ou G. MOIGNET,
Grammaire de l'ancien français, Paris, Klincksieck.
- O. BLOCH et W. von
WARTBURG,
Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, (ouvrage de
fond pour la bibliothèque d'un professeur de Lettres)
- ou (d’un prix
nettement plus abordable) :
E. BAUMGARTNER et
Ph. MENARD,
Dictionnaire étymologique et historique de la langue française,
Livre de poche, « Les Usuels de Poche », 1996.
- N. ANDRIEUX-REIX,
Ancien Français, fiches de vocabulaire, PUF, coll. "études
littéraires".
Pour prendre une vue
d’ensemble des questions relatives à l’histoire du français, on pourra
compléter son information en consultant les ouvrages suivants :
- M. PERRET,
Introduction à l’histoire de la langue française, Paris, SEDES, 2e édition revue, 1999 (Campus) ;
- J. PICOCHE et C.
MARCHELLO-NIZIA,
Histoire de la langue française, Paris, Nathan Université, 1989.
Enfin, même s’ils ne portent
pas sur l’ancien français, pour la maîtrise des notions
linguistiques :
- M. ARRIVÉ,
F. GADET, M. GALMICHE,
La Grammaire d’aujourd’hui, Paris, Flammarion.
N.B. Il s’est publié depuis
une quinzaine d’années quantité de petits ouvrages d’initiation à l’ancien
français visant le public des candidats aux concours. Leur valeur est très
inégale. Il en est de très bons, comme la
Petite Grammaire de l'ancien français de H. Bonnard et
Cl. Régnier, aux éditions Bordas, ou le
Petit Traité de langue française médiévale de
N. Andrieux-Reix, C. Croizy-Naquet, F. Guyot et
E. Oppermann, publié dans la collection "études littéraires" des PUF.
Mais il peut en exister de franchement mauvais. Aucun n’est susceptible de
remplacer l’un quelconque de ceux qui sont indiqués ci-dessus.
Il faut signaler par ailleurs
les ouvrages publiés chaque année sur les textes au concours. Ils valent
ce que valent leurs auteurs. Ceux des éditions Atlande sont généralement
de bonne qualité. On ne saurait en dire autant des autres.
OUVRAGES À CONSULTER PONCTUELLEMENT EN BIBLIOTHÈQUE : La B.U. possède un ouvrage ancien, mais très
complet et de maniement assez aisé, notamment pour la syntaxe :
- K. NYROP,
Grammaire historique de la langue française, 4e éd. revue, 6 vol., Genève, Slatkine Reprints, 1979.
1. Phonétique et
morphologie historiques
- P. FOUCHÉ,
Phonétique française, 3 vol., Klincksieck, 1952, 1958, 1961 :
c'est l'ouvrage de base, hélas à peu près introuvable aujourd'hui, sinon à
la BU de Lille (celle d'Arras possède seulement le premier volume, limité
à l'introduction).
- P. FOUCHÉ,
Morphologie historique du français. Le Verbe, Klincksieck : un
peu ancien mais assez maniable, même s'il manque de perspective
systématique.
- F. de LA CHAUSSÉE,
Initiation à la phonétique historique de l'ancien français,
Klincksieck : présentation plus confuse que celles de G. ZINK et
G. JOLY (bien qu'elle affirme des soucis pédagogiques), mais analyses
articulatoires plus sûres.
- G. ZINK,
Phonétique historique du français, PUF (manuel très pratique, mais
dont les explications parfois contestables ne sont plus que tolérées par
le jury).
- M.K. POPE,
From Latin to Modern French with Especial Consideration of
Anglo-Norman, Manchester University Press : ouvrage ancien, mais
très complet et toujours utile. Concerne la phonétique et la morphologie,
et est particulièrement exploitable dans ce dernier domaine. À aborder par
les index.
- N. ANDRIEUX-REIX et
E. BAUMGARTNER,
Systèmes morphologiques de l'ancien français. Le Verbe, Bordeaux,
Bière : le premier ouvrage présentant les problèmes dans une
perspective tant soit peu linguistique, c'est-à-dire en privilégiant la
synchronie de l'ancien français et l'analyse en bases et morphèmes, sans
pour autant ignorer la perspective diachronique ; permet réellement,
dès lors qu'on a fait l'effort de le maîtriser, de comprendre le
fonctionnement du système et d'éviter les mémorisations inutiles (et
parfois illusoires). C’est lui qui sert de base aux cours de morphologie
pour la synchronie.
Enfin, depuis quinze ans, les
ouvrages de phonétique destinés à la préparation des concours se sont
multipliés. Vous pourrez ainsi consulter à l’occasion :
- N. ANDRIEUX-REIX,
Ancien et Moyen Français, exercices de phonétique, PUF, coll.
« Études littéraires », 1993.
- G. JOLY,
Fiches de phonétique, Paris, Colin, 1999.
- M. LEONARD,
Exercices de phonétique historique (avec des rappels de cours),
Nathan-Université, collection «
Cahiers 128 » (pratique pour une remise à niveau).
Un ouvrage analogue a été consacré à la
morphologie :
- N. ANDRIEUX-REIX et
E. BAUMGARTNER,
Ancien français, exercices de morphologie, PUF, coll. « études
littéraires », 1993.
On ajoutera une dernière
référence trop peu souvent exploitée : les articles morphologiques (
adjectif,
article,
nom, etc.) du
Grand Larousse de la langue française en sept volumes, qui sont dus
à H. BONNARD, et présentent les explications les plus claires au plan
diachronique. La BU en possède deux exemplaires.
2. Syntaxe Les ouvrages fondamentaux
sont ceux de Ph. MÉNARD et G. MOIGNET, à compléter désormais par
le
Précis de G. JOLY. On pourra occasionnellement recourir
à :
- L. FOULET,
Petite Syntaxe de l'ancien français, Champion (Classiques Français
du Moyen Age) : limpide et à peu près inusable.
- Cl. BURIDANT,
Grammaire nouvelle de l’ancien français, Paris, SEDES, 2000 :
ouvrage très complet, mais de maniement parfois difficile du fait de sa
terminologie.
3. Vocabulaire Outre vos dictionnaires personnels, vous
devrez utiliser les deux grands dictionnaires d'ancien français pour vous
faire une idée des divers emplois possibles des mots les plus
importants :
- F. GODEFROY,
Dictionnaire de l'ancienne langue française, 10 vol., 1880-1902
(les faux amis se trouvent majoritairement dans le supplément publié dans
les vol. 8 à 10) : le seul dictionnaire français de cette dimension.
- TOBLER
et LOMMATZSCH,
Altfranzösisches Wörterbuch, publication en cours depuis 1925 (les
trois dernières lettres de l'alphabet manquent encore) : c’est le
seul ouvrage qui fasse véritablement autorité, même s’il ne remplace pas
entièrement le précédent.
- Pour les fiches de
vocabulaire, outre les irremplaçables
Fiches de N. ANDRIEUX-REIX (qu'il faut d'abord utiliser comme
un manuel fournissant une méthode de travail), on devra consulter
prioritairement :
- G. GOUGENHEIM,
Les Mots français dans l'histoire et dans la vie, 3 vol., Paris,
Picard : ouvrage très riche et dont les divers chapitres se lisent comme
autant de petits romans.
On pourra aussi recourir aux
ouvrages suivants :
- J. CHAURAND,
Introduction à l'histoire du vocabulaire français, Paris,
Bordas : court manuel à l'usage des étudiants, il vise le vocabulaire
dans son ensemble plutôt que les mots particuliers. L'idéal serait de
l'avoir lu avant la rentrée.
- E. HUGUET,
Mots disparus ou vieillis depuis le XVIe s., Genève,
Droz, et
- E. HUGUET,
L'Evolution du sens des mots depuis le XVIe s., Genève,
Droz : aident à comprendre les modifications intervenues dans le
vocabulaire à l'époque classique, et contribuent à fournir des éléments de
datation dans ce domaine.
L’orientation actuelle de la
question vers la connaissance du vocabulaire tel qu’il est employé par le
texte ne nécessite qu’occasionnellement le recours aux grands
dictionnaires étymologiques.
Les compléments nécessaires
seront fournis à la rentrée.
Pour les états connus par le
vocabulaire depuis le Moyen Âge, on recourra principalement :
- pour la langue de la
Renaissance, à E. HUGUET,
Dictionnaire de la langue française du XVIe s. (ne
mentionne que les valeurs de sens disparues en f.m.).
- pour le XVIIe s., aux
Dictionnaires de FURETIÈRE, de RICHELET et de l’Académie.
- pour le XVIIIe et le XIXe s. (mais pas pour les étymologies), au
Dictionnaire de LITTRÉ.
- pour la langue moderne, au
Trésor de la Langue Française, au
Grand Larousse de la langue française et au
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de
P. ROBERT.
Il vous sera bien entendu
impossible de préparer individuellement toutes les fiches nécessaires. Vous devrez donc :
- pour les mots les plus importants, travailler en
équipes ;
- pour les autres, bien connaître les articles qui leur sont
consacrés dans un dictionnaire d'ancien français et dans un dictionnaire
étymologique simple.
4. Plusieurs manuels
peuvent encore être exploités :
- A. LANLY,
Fiches de philologie française, Paris, Bordas : consacré à des
mots : phonétique, morphologie, sémantique.
- J. BATANY,
Français médiéval, Paris, Bordas : manuel remarquable fondé
sur une série d'exercices et de corrigés, et comportant une introduction
où sont exposés des conseils de méthode et le minimum indispensable en
phonétique, et plusieurs index (phonétique, grammaire, vocabulaire).
- A. QUEFFÉLEC et
R. BELLON,
Linguistique Médiévale. L’épreuve d’ancien français aux concours,
Paris, Armand Colin, 1995. Il propose lui aussi une série d’exercices et
de corrigés types.
- ÉTUDE GRAMMATICALE ET STYLISTIQUE : TEXTE POSTÉRIEUR À 1500 - Enseignants : Dany
AMIOT (grammaire) et FRANÇOIS RAVIEZ (stylistique)
Bibliographie :
Ouvrages généraux Quelques titres pour se
familiariser avec le domaine des sciences du langage :
- DUCROT, O. et SCHAEFFER, J.-M. 1995.
Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.
Paris : Le Seuil.
- FLAUX, N. 1997
.
La Grammaire. Paris : PUF. coll. « Que
sais-je ? ». n° 788.
- SOUTET, O. 1996.
La Linguistique. Paris : PUF. [en particulier à partir de la
page 103 « Les fonctions du langage », depuis les questions
de sémantique, de pragmatique, jusqu'aux problèmes de cohésion textuelle,
en passant par la phonétique, morphologie, syntaxe... ]
Grammaires
- DENIS, D. & SANCIER-CHATEAU, A. 1994.
Grammaire du français. 2nde éd. 1997. Paris : Le Livre de Poche. [petit ouvrage
bien fait, présenté par ordre alphabétique ; introduction très
intéressante.]
- GREVISSE, M. 1997.
Le Bon Usage - Grammaire française. 13ème éd. refondue par André Goosse. Paris /
Louvain-la-Neuve : DeBoeck /Duculot.
- LE GOFFIC, P. 1993.
Grammaire de la phrase française. Paris : Hachette.
[intéressante à consulter pour des analyses concernant la phrase simple et
la phrase complexe.]
- RIEGEL, M. ; PELLAT, J.-C. & RIOUL, R. 1994.
Grammaire méthodique du français. 3ème éd. 2004. Paris : PUF. [Consulter régulièrement cette
grammaire est le minimum indispensable pour votre préparation au
concours.]
- WILMET, M. 1997.
Grammaire critique du français, Louvain-la-Neuve :
Hachette-Duculot.
- Un ouvrage un peu plus
ancien, présenté sous forme de dictionnaire alphabétique des notions,
traite succinctement de chacune d’elles, mais ouvre des perspectives plus
larges qu’une grammaire traditionnelle (il possède par exemple des entrées
telles que
grammaire générative, javanais, ou
lexique) :
ARRIVE, M. ; GADET, F.
& GALMICHE, M. 1986.
La Grammaire d'aujourd’hui. Paris : Flammarion.
- Pour une révision ou une mise
à niveau des connaissances minimales exigées au concours :
- GARDES-TAMINE, J. 2002 / 2004.
La Grammaire. t. 1 et 2. Paris : Armand Colin. [le tome 1
concerne la phonologie, la morphologie et la lexicologie ; le tome 2,
la syntaxe.]
Lexique et sémantique
lexicale a) Dictionnaires
- BAUMGARTNER, E. et MENARD, Ph. 1996.
Dictionnaire étymologique et historique de la langue française.
Paris : Le Livre de Poche.
- DUBOIS, J. ; LAGANE, R. et LEROND, A. 1988.
Dictionnaire du français classique. 3ème éd. 2001. Paris : Larousse.
- GRFL,
Grand Robert de la langue française. 6 vol. 1964. Paris : Les
éditions Le Robert. [existe sur CD Rom ; paru en 2005, fondé sur la
dernière édition papier, qui date de 2001]
- LITTRÉ, E. 1863.
Dictionnaire de la langue français. Paris : Librairie de L.
Hachette et Cie. Rééd. Paris : Gallimard-Hachette. 1964-1965. [le
Littré est consultable en ligne sous la dénomination
XMLittré à l’adresse suivante :
http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php]
- REY, A.
et alii. 2006.
Dictionnaire historique de la langue française. 3 vol. Paris :
Dictionnaires Le Robert. [existe aussi en version brochée, mais l’édition
est plus ancienne : 1998]
- TLF : Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du
19e et du 20e siècle (1789-1960), 16 vol.,
Paris : Éditions du CNRS (t. 1-10) / Gallimard (t. 11-16),
1971-1994. [consultable en ligne sous la dénomination
TLFi :
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm]
b) Ouvrages
- LEHMANN, A. & MARTIN-BERTHET, F. 1998.
Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie.
Paris : Dunod.
- LERAT, P. 1983.
Sémantique descriptive. Paris : Hachette.
- MORTUREUX, M.-F. 1998.
La Lexicologie entre langue et discours. Paris : SEDES.
- PICOCHE, J. 1993.
Précis de lexicologie française. Paris : Nathan.
- TAMBA-MECZ, I. 1981.
Le sens figuré. Paris : PUF.
- TAMBA-MECZ, I. 1988.
La sémantique. Paris : PUF.
- TOURATIER, C. 2000.
La sémantique du français. Paris : A. Colin.
Syntaxe et
morphosyntaxe
- GLLF : Grand Larousse de la langue française. Guilbert L.,
Lagane, R. & Niobey, G. (éds). 1971-1978. 7 vol. Paris :
Librairie Larousse [on trouve dans ce dictionnaire des articles de
grammaire (un peu anciens mais intéressants) rédigés par Henri
Bonnard ; la liste de ces articles figure en tête du tome VII.]
- SOUTET, O. 1998.
La Syntaxe du français. Paris : PUF. coll. « Que sais-je
? ». n° 984.
Spécialisation concours
Vocabulaire :
- LEDUC-ADINE, J.-P. & PETIOT, G. 1993. « La question de
vocabulaire aux concours».
L’Information Grammaticale 57 : 31-36. [petit article qui
donne de bons conseils.]
Morphosyntaxe :
- MAINGUENEAU, D. 2004.
Précis de grammaire pour les concours. Paris : Bordas.
- MERCIER-LECA, Fl. 1998.
Trente questions de grammaire française. Paris : Nathan.
« Cahiers 128 ».
- MONNERET Ph. & RIOUL, R.
1999.
Questions de syntaxe française. Paris : PUF.
[ces ouvrages proposent un
entraînement méthodique et des sujets corrigés.] Stylistique a) manuels et instruments
méthodologiques généraux
- Adam (Jean-Michel),
La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des
discours, Armand Colin, 2005.
- Calas (Frédéric) et
Charbonneau (Dominique-Rita),
Méthode du commentaire stylistique (2000), Armand Colin, coll.
« Cursus », 2005.
- De Boissieu (Jean-Louis) et
Garagnon (Anne-Marie),
Commentaires stylistiques, Sedes, 1987.
- Dictionnaire des termes littéraires, Champion Classiques, coll.
« Références et dictionnaires », 2005.
- Herschberg-Pierrot (Anne),
Stylistique de la prose (1993), Belin, coll. « Belin
Sup-Lettres ».
- Jarrety (Michel) (dir.),
Lexique des termes littéraires, Le Livre de Poche, 2001.
- Maingueneau (Dominique),
Éléments de linguistique pour le texte littéraire (1986), Nathan
université, coll. « Lettres sup », 2000 ;
Pragmatique pour le discours littéraire (1990), Nathan université,
coll. « Lettres Sup », 2001.
b) rhétorique et argumentation
- Amossy (Ruth) et
Herschberg-Pierrot (Anne),
Stéréotypes et clichés. Langue, discours, société, Nathan, coll.
« 128 », 1997.
- Declercq (Gilles),
L’art d’argumenter. Structures rhétoriques et littéraires, Editions
Universitaires, 1992.
- Formilhague (Catherine),
Les figures de style, Nathan université, coll. « 128 »,
1995.
- Fumaroli (M.),
L’Âge de l’éloquence, Droz, coll. « Titre courant »,
2002.
- Molinié (G.) et ALQUIEN
(M.),
Dictionnaire de Rhétorique et de Poétique, La Pochothèque, Le Livre
de Poche, 1999.
c) poésie
- Buffart-Moret (Brigitte),
Précis de versification (1997), Armand Colin, coll. « Lettres
Sup », 2004.
- Dürrenmatt (Jacques),
Stylistique de la poésie, Belin, coll. « atouts », 2005.
d) description
- Adam (Jean-Michel) et
Petitjean (André),
Le texte descriptif, Nathan université, 1989.
- Hamon (Philippe),
Du descriptif (1981), Hachette supérieur, coll. « Recherches
littéraires », 1993.
e) roman et texte narratif
- Adam (J.-M.) et Revaz (F.),
L’analyse des récits, Seuil, coll. « Mémo », 1996.
- Cohn (Dorrit),
La transparence intérieure. Modes de représentationde la vie psychique
dans le roman (1978), Seuil, coll. « Poétique », 1981.
- Démoris (R.),
Le Roman à la première personne, Droz, coll. “Titre courant”, 2002.
- Eco (Umberto),
Lector in fabula.
Le rôle du lecteur (1978), Le Livre de Poche, coll. « Biblio
essais », 2001.
- Genette (Gérard), « Le
discours du récit », in
Figures III, Seuil, coll. « Poétique », 1972.
f) théâtre et texte dialogal
- Kerbrat-Orecchioni
(Catherine),
La conversation, Seuil, coll. « Mémo », 1996.
- Ubersfeld (Anne),
Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre (1996), Belin, coll.
« Lettres Sup » ;
Les termes clés pour l’analyse du théâtre, Seuil, coll.
« Mémo », 1996.
- EXPLICATION ORALE -
enseignants : Patrice MEIMOUN et velyne THOIZET
bibliographie :
- Bemard GICQUEL,
L'explication de texte et la dissertation, P.U.F., coll. « Que sais-je ? » n° 1805.
- Paul RENARD (dir.),
L'explication de textes littéraires, éd. Ellipses.
- Chantal LABRE et Patrice SOLER,
Méthodologie littéraire, P.U.F., coll. « Premier cycle ».
- VERSION : ANGLAIS -
enseignant : Patrick VIENNE
bibliographie :
N.B. : Les titres marqués d'un astérisque (*) sont disponibles à la B.U. d'Arras. Dictionnaires unilingues
anglais
recommandés :
Collins Cobuild English Language Dictionary -
Harrap’s Chambers English Dictionary - Oxford Advanced Learner’s
Dictionary - Longman Dictionary of Contemporary English - Macmillan
Dictionary for Advanced Learners -
Webster’s Collegiate Dictionary (U.S.).
-
Aide à la version -
- Dictionnaire des synonymes (Ed. Le Robert) ; ou mieux, Thésaurus, dir. D. Péchoin, Larousse, coll. « in extenso » (outil
très utile, du type dictionnaire analogique, qui répertorie par thème les mots de toute nature et expressions correspondant à une idée. Permet d'étoffer son vocabulaire et de choisir le mot ou l'expression justes en orientant parfois vers des directions insoupçonnées).
Parmi les ouvrages qui suivent, les deux premiers se placent surtout au niveau du groupe de mots ou de la phrase ; le 3e envisage le texte comme un tout qu'il faut analyser afin de le traduire au mieux (utilisation du contexte).
- F. Grellet,
Initiation à la version anglaise. The Word Against the Word (Hachette Supérieur)*
- M. Ballard,
La Traduction de l'anglais au français (Nathan Université, puis, désormais, Armand-Colin)*
- M. Golaszewski, M. Porée :
Méthodologie de l'analyse et de la traduction littéraires. De la lettre à l'esprit (Ellipses)*
-
Grammaires -
- Thomson, Martinet,
A Practical English Grammar (Oxford) - Ouvrage de référence (en anglais), avec recueils d'exercices.
- S. Berland-Delépine,
Grammaire pratique de l'anglais ou
Grammaire anglaise de l'étudiant (Ophrys) - Gros volumes de grammaire traditionnelle. Listes de règles visant à l'exhaustivité mais pas forcément à la cohérence théorique ni à la clarté de la présentation (il est souvent difficile de distinguer ce qui est important de ce qui l'est moins, mais l'index est précieux).
-
Commentaire littéraire -
Avant de choisir ce qu'il faut consulter, il est sans doute utile de savoir que les textes proposés à l'oral du CAPES de Lettres semblent pour l'essentiel être tirés d'oeuvres de la 2e moitié du XXe siècle. Toutefois, rien n'indique qu'il ne puisse y avoir des textes plus anciens (la limite étant sans doute 1850).
Vocabulaire littéraire :
- F. Grellet,
A Handbook of Literary Terms (Hachette Université)* - combine lexique littéraire et éléments de méthodologie du commentaire ; vocabulaire aussi bien courant que très pointu (entièrement en anglais) ;
- M. Quivy,
Glossaire bilingue des termes littéraires, français-anglais (Ellipses)* ;
- David Lodge,
The Art of Fiction (Penguin)* /
L'Art de la fiction (Rivages-Payot)* - Ouvrage clair (dont l'auteur est universitaire et romancier), destiné à des non-spécialistes (à l'origine publié sous forme d'articles dans un quotidien), idéal pour commencer ; classement par thèmes, où un extrait commenté est le point de départ à une analyse de portée générale.
- Claudine Verley,
Lectures critiques en anglais. A Guide to the Critical Reading of Fiction in English (Ophrys)* - Introduction au commentaire de texte en anglais dans un bref ouvrage (à un prix abordable) qui met l'accent sur la méthodologie. Beaucoup d'exemples pratiques (entièrement en anglais).
- Shlomith Rimmon-Kenan,
Narrative Fiction, Contemporary Poetics (Routledge)* - Petit usuel théorique d'un abord aisé et pas trop jargonnant. Contenu simple, mais il reste intéressant pour commencer, pour se faire à la langue critique anglaise.
- P. Castex, A. Jumeau,
Les Grands Classiques de la littérature anglaise et américaine (Hachette Supérieur) - Présentation par genre (poésie, théâtre, fiction) : introductions sur les techniques propres à chaque genre puis séries de textes avec présentation des auteurs et questions pour guider l'analyse (de Shakespeare à George Orwell ; entièrement en anglais).
- E. Taane,
L'explication de texte, Méthode et pratique (domaine anglais) (Hachette Supérieur)* - Présentation théorique générale (en français), puis, pour chaque texte, pas-à-pas méthodologique (en français) et propositions de commentaires en anglais ou en français (poésie, théâtre, fiction ; de Shakespeare à Toni Morrison).
- T. Hughes, C. Patin,
L'analyse textuelle en anglais. Narrative Theory, Textual Practice (Dunod)* - Brèves présentations théoriques d'éléments méthodologiques essentiels pour le commentaire, appliqués ensuite à divers exemples de textes ; système de questions / réponses (entièrement en anglais ; fiction uniquement ; de Henry James à Julian Barnes).
- P. Auffret, P.-G. Boucé,
Figures libres, figures imposées (Hachette Université)* - Dix spécialistes d'un domaine présentent un texte de leur choix (gb et us), puis commentent deux extraits imposés (C. Dickens et F.S. Fitzgerald).
-
Ouvrages de référence : histoire littéraire, civilisation -
Il peut être utile de les consulter, en particulier les ouvrages d'histoire littéraire, afin de se familiariser avec les grandes figures et saisir certains arrière-plans culturels ou théoriques.
- Dictionnaire des littératures de langue anglaise (Encyclopædia Universalis, Albin Michel)* - présentation biographique et littéraire des grands auteurs ; voir surtout les articles concernant chaque pays : « Anglaise (littérature) », « États-Unis », « Canada », « Inde »,
etc.
- F. Grellet, An Introduction to American Literature. Time Present and Time Past*, et, avec M.H. Valentin, An Introduction to English Literature.
From Philip Sidney to Graham Swift (Hachette Supérieur) - Destinés aux premières années de l'enseignement supérieur. Classements par périodes, avec présentation de l'histoire des idées puis des principaux auteurs. Pour chaque auteur, un extrait et des documents explicatifs (textes et/ou images) sont présentés. Le 2
e ouvrage commence par une introduction méthodologique sur les différents genres littéraires (entièrement en anglais).
- Précis : des histoires des littératures anglaise et américaine existent chez différents éditeurs :
« Que sais-je »,
puf (J. Raimond, n°159, 1997* et D. Royot, n° 407, 2004*),
« Les Fondamentaux », Hachette (E. Angel-Perez, 2000* et P. Lagayette, 2001*),
« 128 », Nathan (J. Hérou et L. Bitoun, C. Grimal) ou encore chez
Ellipses.
-
Vocabulaire -
- C. Bouscaren, F. Lab,
Les mots anglais en contexte*, ou en version non abrégée : C. Bouscaren, F. Lab,
Les Mots entre eux. Words and their Collocations* (Ophrys) - Listes par thèmes complétées par des phrases de mise en situation et des exercices ; pour l'aide à un emploi correct du vocabulaire et le repérage de formules figées.
- J. Rey, C. Bouscaren, A. Mounolou,
Le Mot et l'idée (Ophrys)* : 2 volumes, vocabulaire et exercices - un classique des listings.
- F. Grellet,
In So Many Words : 200 exercices pour mieux maîtriser le vocabulaire anglais (Hachette, HU Anglais)*
-
Aide à la lecture -
Aussi bien pour la version que pour le commentaire, il est utile (voire nécessaire) de se familiariser très tôt avec la lecture suivie de textes en anglais, afin d'acquérir du vocabulaire de manière plus attrayante qu'en apprenant des listes, de se libérer du dictionnaire en se servant du contexte pour saisir le sens de certaines phrases ou certains mots et en considérant les textes dans leur totalité. En fonction des goûts et surtout des besoins :
- Collections « Oxford Bookworms Library », « Penguin Readers » (entre autres) - en guise de bouée de sauvetage ; brefs volumes comprenant des oeuvres de tous types, de
Jane Eyre à Philip K. Dick en passant par
Dracula et le roman policier, adaptées en fonction du degré de difficulté du vocabulaire ; classement par niveau ; certains disposent du texte sur cassette ou CD.
- Les maisons d'édition françaises proposent divers types d'ouvrages pour apprendre à lire en anglais :
-
Livre de Poche, coll. « Lire en Anglais » - vocabulaire difficile expliqué en face du texte original.
- Méthode « bilingue » (traduction de tout le texte face au texte anglais) :
Livre de Poche, coll. « Bilingue » (plutôt les textes classiques, Joseph Conrad, Ernest Hemingway...) ;
Pocket, coll. « Langues pour tous » (textes relativement récents, souvent des nouvelles) - « Folio Bilingue » (textes classiques) ;
- F. Grellet, 10 Short Stories, From Guided Reading to Autonomy (Hachette éducation), 2 vol*.
- Moffet, McElheny (eds), Points of View. An Anthology of Short Stories (Mentor, 1995)*. Recommandé par le jury du CAPES il y a quelques années.
- Puis des auteurs tels que Ernest Hemingway (The First Forty-Nine Stories, The Old Man and the Sea), Francis Scott Fitzgerald (The Great Gatsby), Paul Auster (Timbuktu, Oracle Night...), James Joyce (Dubliners - éviter Ulysses et surtout Finnegans Wake pour le moment), Harold Pinter pour le théâtre...
- On profitera aussi d'une lecture au moins partielle ou un peu au hasard d'une oeuvre en anglais (quelle qu'elle soit) à la suite d'une lecture en français, la connaissance de l'intrigue et du contexte facilitant la compréhension de certains détails (par exemple le premier
Harry Potter de J.K. Rowling,
Harry Potter and the Philosopher's Stone, éd. Bloomsbury*).
-
Aides à la pratique de la langue -
Dans ce domaine, toute pratique régulière, tout au long de l'année, est utile et profitable,
quel que soit le support.
Audio-visuel :
a) Radio : BBC World Service (infos 24h/24) : Ondes Moyennes, 648 kHz -
par Internet : longues listes de radios de tous pays disponibles en « streaming » sur
www.radio-locator.com ou
www.vtuner.com/index.html
entre autres, avec liens vers les sites de ces stations (catégories
Talk,
News). Voir
www.bbc.co.uk/radio/, ou le réseau de radios publiques américaines NPR (
www.wnyc.org pour l'antenne locale de New York).
b) DVD : puisque ce support permet la présence de plusieurs bandes son, passer progressivement de la Version originale sous-titrée en français (on bannira la version française), à la Version originale sous-titrée en anglais, puis à la Version originale non sous-titrée du même film.
Internet : en plus des radios, n'hésitez pas à utiliser des sites anglo-saxons pour vos recherches ou pour consulter journaux,
blogs ou autres sur vos centres d'intérêt particuliers.
Séjours : Un séjour en immersion complète (aucune possibilité de parler français pendant le séjour) est le meilleur moyen d'apprendre une langue. On n'apprend jamais mieux que lorsqu'on doit s'exprimer en anglais pour ne pas dormir sous un pont ou pour manger autre chose que de mauvais hamburgers.
- VERSION : ESPAGNOL -
enseignant : Jean-Michel SANCHEZ
bibliographie :
1. grammaire
- GERBOIN Pierre et LEROY Christine,
Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Hachette Supérieur.
- BESCHERELLE,
El arte de conjugar en español, Paris, Hatier.
- BOUZET Jean,
Grammaire espagnole, Paris, Belin.
- COSTE Jean et BAQUE Monique,
Grammaire de l'espagnol moderne, Paris, Sedes.
2. dictionnaires bilingues
- DENIS S. et Maraval M.,
Dictionnaire franco-espagnol, Paris, Hachette, 1960.
- GARCIA-PELAYO R. et TESTAS J.,
Grand Dictionnaire français-espagnol et espagnol-français, Paris, Larousse.
3. dictionnaires unilingues
- Le meilleur actuellement : Diccionario de la lengua española, 2 vols + cd-rom (22ª ed),
Real academia española, Espasa calpe, 2003
- ou Diccionario de la lengua española, 2 vols. (22ª ed.),
Real academia española, Espasa calpe, 2001
- également : Dicconario Planeta de la lengua usual, Editorial Planeta.
- Très utile en raison des nombreuses illustrations : El pequeño larousse Ilustrado, 2004, Diccionario enciclopédico, Larousse.
4. ouvrages utiles
- SECO M., Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Edit. Aguilar, 1976 (réédition).
- SANDALINAS J.,
Vocabulaire de l'étudiant - Espagnol, Ellipses.
- HERNANDEZ,
La pratique du vocabulaire espagnol, Nathan, « Repères pratiques » n° 57, 1998.
5. histoire de l'Espagne
- VILAR Pierre,
Histoire de l'Espagne, « Que sais-je ? » n° 275, PUF, 2001.
6. histoire de L'Amérique latine
- CHAUNU Pierre,
Histoire de l'Amérique latine, « Que sais-je ? » n° 361, PUF, 2003.
- GALEANO,
Les veines ouvertes de l'Amérique latine, Pocket, coll. « Terre humaine » n° 3022, 2001.
7. version espagnole
- BOUCHER Jean et BARO-VANELLY Marie-Christine,
Fort en version, espagnol, Visas Langues, Bréal.
- DEGUERNEL Alain et le MARCHADOUR Rémi,
La version espagnole, collection 128, Nathan Université.
8. commentaire
- TERRASA Jacques,
L'analyse du texte et de l'image en espagnol, coll. « Fac ». Langues étrangères, Nathan Université.
- ZUILI Marc,
Introduction a l'analyse des textes espagnols et hispano-americains, Nathan Université. collection « 128 ».
- LÁZARO CARRETER Fernando y CORREA Calderón, Cómo se comenta un texto literario, Madrid, Cátedra Col, Critica y estudios, 1985.
- REDA-EUVREMER Nicole,
La littérature espagnole au XXe siècle, Armand Colin.
- PARDO Madeleine et PARDO Arcadio, Précis de métrique espagnole, Nathan Université, collection « 128 ».
- BENMOUSSAN Albert et Martine et LE BIGOT Claude,
Versification espagnole suivi de
Petit traité des figures, Presses universitaires de Rennes, 1993.
Nous conseillons à tous les étudiants la lecture assidue de romans et de nouvelles en espagnol pour affiner leur sensibilité littéraire ainsi que pour compléter leurs connaissances lexicales. On aura recours avec profit aux collections :
- Les Langues pour tous éditions Pocket, qui proposent notamment des nouvelles espagnoles ou hispano-américaines contemporaines dans la série bilingue.
- Lire en espagnol, Les Langues Modernes, Le Live de Poche.
- VERSION : ALLEMAND -
enseignant : Jean-Marc LAGARDE
bibliographie :
- La compréhension de l'allemand - Langue et culture par Anne BESANÇON (Peter Lang - 1995).
- Fort en version par Monique WILNET et Thérèse ROBIN (Bréal 2001).
- Guide de l'explication de textes pour germanistes par Jan SCHNEIDER (Ellipses - 1998).
- Guide pratique de l'explication de texte en allemand du Deug au Capes par A. FAURE, C. GEITNER et R. SAUTER (Armand Colin - 1997).
- Les mots allemands par R. F. NIEMANN (Hachette - 1997).
- Histoire de la littérature allemande par Hans HARTJE (Ellipses - 2001).
- Littérature allemande par Pierre DESHUISSES (Dunod - 1991).
N.B. : Tous ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque universitaire. Il est d'autre part indispensable de disposer d'un dictionnaire bilingue de bonne taille, d'un dictionnaire unilingue (Wahrig) et d'une grammaire allemande.
- VERSION : LATIN -
enseignant : Jean-Marc VERCRUYSSE
bibliographie :
1. dictionnaire et grammaire
- F. GAFFIOT,
Le Grand Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, Hachette, Paris
2000.
Nouvelle version, revue et augmentée, du
fameux Gaffiot
à posséder absolument. Les annexes et les cartes en couleurs peuvent
être utiles, et la présentation des articles longs a gagné en
lisibilité.
- La grammaire que vous
utilisez jusqu’à présent. Si vous ressentez néanmoins le besoin d’en
acquérir une nouvelle :
M. LAVENCY,
Usus. Description du latin classique en vue de la lecture des
auteurs, Duculot, Paris-Gembloux 2003.
2. littérature
- H. ZEHNACKER et J.-Cl.
FREDOUILLE,
Littérature latine, coll. « Quadrige / Manuels », Presses
Universitaires de France, Paris 2005.
Les auteurs sont présentés
chronologiquement dans le cadre historique et social de leur génération.
Pas de textes traduits. Les cent cinquante dernières pages sont réservées
à la littérature chrétienne ainsi qu’à la littérature païenne tardive.
- J.-P. NÉRAUDAU,
La Littérature Latine, coll. « Langues et civilisations
anciennes », Hachette Supérieur, Paris 2000.
Panorama de la littérature latine très
didactique (divers encadrés) avec des extraits traduits accompagnés de
l’original latin. Bibliographie essentielle et à jour pour chaque
auteur.
- J. GAILLARD et R. MARTIN,
Les genres littéraires à Rome, Scodel-Nathan, Paris 1994.
Comme le titre l’indique, les deux
universitaires présentent les oeuvres en fonction de leur appartenance aux
genres littéraires. A l’intérieur de chaque genre, le parcours est
chronologique. L’ouvrage a bénéficié du renouvellement des lectures
provoqué par la « nouvelle critique ». Des extraits traduits de
manière très vivante.
3. histoire et civilisation
- G. HACQUART, J. DAUTRY et
O. MALSINI,
Guide romain antique, Hachette, Paris 1967 (1952).
- M. RAT,
Aide mémoire de latin, Nathan, Paris 2002 (1936).
Deux petits manuels scolaires, anciens
mais classiques, et toujours réédités. Le premier est plus complet que le
second.
- M.C. HOWATSON (dir.),
Dictionnaire de l’Antiquité (Mythologie, littérature,
civilisation), coll. « Bouquins », Robert Laffont, Paris
1993.
En un volume (1070 p.) et pour un prix
raisonnable (cf. la collection), une somme d’informations considérable sur
l’Antiquité grecque et romaine réunie par des professeurs de l’université
d’Oxford. Petit atlas en fin de volume. Pas de bibliographie.
- J. LECLANT (dir.),
Dictionnaire de l’Antiquité, coll. « Quadrige », PUF,
Paris 2005.
En un copieux volume (2390
p.), la plus récente encyclopédie en format de poche sur l’Antiquité
(Égypte, Proche-Orient, Grèce, Rome). Bibliographie essentielle pour
chacun des 3200 articles. Index fort utile mais absence de cartes.
- M. LE GLAY, J.-L. VOISIN et
Y. LE BOHEC,
Histoire romaine, coll. « Premier Cycle », Presses
Universitaires de France, Paris 1991.
Panorama très complet en
trois parties (Des origines à l’empire / Rome, maîtresse du monde / Un
autre monde romain IIIe-Ve siècle) avec tableaux
chronologiques et généalogiques, encadrés et illustrations.
- P. GRIMAL,
Histoire de Rome, Mille et une nuits
, Paris 2004.
En 160 pages, l’éminent latiniste français
parvient à couvrir l’ensemble de l’histoire de Rome, de Romulus à
Constantin.
- F. DUPONT,
Le citoyen romain sous la République (509-27 av. JC), coll.
« La vie quotidienne »,Hachette, Paris 1994.
Dans une collection célèbre (voir aussi le
volume de J. Carcopino sur la Vie quotidienne à Rome à l’apogée de
l’Empire romain
), un tableau très vivant de l’activité sociale et privée sous la
République.
- C. SCARRE,
Atlas de la Rome antique (800 av. JC – 540 ap. JC), coll.
« Atlas / Mémoires », Autrement, Paris 1996.
De nombreuses cartes très lisibles et
informatives, accompagnées d’illustrations et de commentaires. Les cinq
parties de l’ouvrage sont précédées d’une introduction spécifique. Le tout
dans un format facile à consulter.
- J. CHAMPEAUX,
La religion romaine, Livre de Poche, Paris 1998.
Cet ouvrage propose non seulement une
histoire de la religion, mais une analyse d'ensemble du fait religieux à
Rome.
- R. MARTIN et
alii,
Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-romaine, Nathan, 1998.
Un dictionnaire de la mythologie s’avère
indispensable. Celui-ci possède l’avantage d’offrir pour chaque article
les références des principales oeuvres littéraires et artistiques qui se
sont inspirées des différents mythes.
- F. BARATTE,
Histoire de l’art antique : l’Art romain, coll. « Manuels
de l’École du Louvre », École du Louvre, Paris 1996.
Après une ample introduction générale,
quatre-vingt-treize chefs-d’oeuvre de l’art romain (sculpture, peinture,
architecture, mosaïque…) sont analysés de manière chronologique : une
illustration en pleine page et en face le commentaire détaillé. Une autre
manière, plaisante et enrichissante, de pénétrer dans la civilisation
romaine...
- ÉPREUVE ORALE SUR DOSSIER - L’épreuve orale sur dossier (É.O.D.),
affectée d'un coefficient 5 (sur un total de 24), relève de la compétence
directe de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M.).
Sa préparation, qui articule des stages en
lycées et collèges et des cours de didactique et de pédagogie, est
organisée majoritairement le lundi toute la journée, selon un calendrier
et une répartition géographique qui seront précisées par l'I.U.F.M. à la
rentrée de septembre.
Il convient néanmoins de rappeler aux
candidats des CAPES littéraires que près de 80% des coefficients sont
réservés aux épreuves disciplinaires de ces concours (Littérature,
Grammaire, Langues) et que l'admissibilité dépend tout entière de
celles-ci.
De ce fait, la préparation universitaire
reste là composante essentielle du travail à fournir.
LES ANNALES 2007
- COMPOSITION FRANÇAISE / 6h -
L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit. Dans En lisant en écrivant
(1980), [José Corti, p. 178] Julien GRACQ - s’adressant au critique
littéraire - déclare : « Un livre qui m’a séduit est comme une femme qui
me fait tomber sous le charme : au diable ses ancêtres, son lieu de
naissance, son milieu, ses relations, son éducation, ses amies d'enfance !
Ce que j'attends seulement de votre entretien critique, c'est l'inflexion
de voix juste qui me fera sentir que vous êtes amoureux, et amoureux de la
même manière que moi : je n’ai besoin que de la confirmation et de
l’orgueil que procure à l'amoureux l’amour parallèle et lucide d'un tiers
bien disant. »
Vous analyserez et discuterez ces
propos en vous appuyant sur des exemples précis.
- ÉTUDE GRAMMATICALE D'UN TEXTE FRANÇAIS ANTÉRIEUR À 1500 / 2h 30 -
L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.
TEXTE
|
[Gaheriet est prêt à se mettre à la poursuite du roi Pellinor et à le
tuer] 1 - Non ferés, biau frere, fait
Gavains. Ensi ne le ferés vous mie, car se vous en lui metiés
main tant comme vous estes escuiiers, vous n'averiés deservi a prendre
hounour de chevalerie.
Mais a moi qui sui chevaliers en laissiés prendre
la venjanche, et je vous di que je la prenderai
si haute coume fiex de roi doit faire de chelui qui son pere occhist.
- Et comment le baés vous a
5 faire, biau frere ? fait Gahariés. -
Je bee, fait il, tant a attendre qu'il soit partis de ceste court.
Et
quant il s'en partira, jou ira apriés et le siurrai une jornee ou
deus. Et si tost comme je le
trouverai seul, qu'il n'i avra fors moi et lui, et s'il est armés, je
l'asaurrai ; et s'il est desarmés,
se li ferai jou prendre armes. Et je me sench si sain et si legier et
si preu de mon cors que je
ne porroie ja cuidier qu'il euust duree viers moi. Et se il plaisoit
a Dieu que je venisse au dessus, je
10 ne lairoie pour tout l'or de cest
siecle que je ne li trenchaisse le chief aussi comme il fist a mon
pere, si comme on me dist. » Et Gahariés dist :« Je ne lairoie en
nule maniere que je ne
l'ochesisse orendroit, se vous ne me creantés que vous n'irés pas
sans moi en cest affaire, si que
je peusse la bataille veoir de vous deus. » Et il li creante coume
freres, et lors laissent ceste
parole atant. La Suite du roman de Merlin,
édition G. Roussineau, Textes Littéraires
Français, Droz,
nouvelle édition 2006 en un volume, § 258. |
QUESTIONS 1. Traduire le texte (5 points). 2. Phonétique (3 points) : a) Donner l'histoire phonétique complète de :
- chief (10), du latin *capu ; b) AU CHOIX :
- Donner l'histoire
phonétique complète de main (2), du latin manum ;
OU
- Graphie : Faites toutes les remarques nécessaires sur le mot
hounour (2) ; vous comparerez avec la forme du français
moderne. 3. Morphologie (4 points) :
a) Relever, classer et conjuguer les formes de
futur I du passage, en justifiant le classement adopté en fonction du
système morphologique de l'ancien français.
b) Étudier la formation et l'évolution du latin au
français moderne du paradigme de avra (7, infinitif latin :
habere). 4. Syntaxe (4 points) :
Etudier la négation dans le passage. 5. Vocabulaire (4
points) :
Étudier :
- partir (5, 6) ;
- siecle (10). - ÉTUDE GRAMMATICALE ET STYLISTIQUE D'UN TEXTE DE LANGUE FRANÇAISE POSTÉRIEURE À 1500 / 2h 30 -
L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.
TEXTE
Les Chercheuses de poux Quand le front de l’enfant, plein de
rouges tourmentes,
Implore l’essaim blanc des rêves
indistincts,
Il vient près de son lit deux grandes
soeurs charmantes
4 Avec de frêles doigts aux ongles argentins.
Elles assoient l’enfant devant une
croisée
Grande ouverte où l'air bleu baigne un
fouillis de fleurs,
Et dans ses lourds cheveux où tombe la
rosée
8 Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs.
Il écoute chanter leurs haleines
craintives
Qui fleurent de longs miels végétaux
et rosés
Et qu'interrompt parfois un
sifflement, salives
12 Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers.
Il entend leurs cils noirs battant
sous les silences
Parfumés ; et leurs doigts électriques
et doux
Font crépiter parmi ses grises
indolences
16 Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux.
Voilà que monte en lui le vin de la
Paresse,
Soupir d'harmonica qui pourrait
délirer ;
L'enfant se sent, selon la lenteur des
caresses,
20 Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.
Arthur RIMBAUD,
Poésies (1870)
|
QUESTIONS 1. Lexicologie (2 points)
Étudiez les mots : terribles (v. 8) ;
indolences (v. 15). 2. Grammaire (8 points)
a. Étudiez les formes verbales à l'infinitif et au
participe. (6 points)
b. Faites toutes les remarques nécessaires
sur :
« Il vient près de son lit deux grandes soeurs charmantes »
(v. 3). (2 points) 3. Stylistique (10 points)
Vous ferez une étude stylistique de ce texte.
- VERSION DE LANGUE / 4h -
Les candidats doivent obligatoirement traduire la version de la langue d'écrit qu'ils ont choisie au moment de leur inscription.
- Version en langue ancienne : dictionnaire latin-français, français-latin, grec-français et français-grec.
- Version en langue vivante (y compris le catalan) : dictionnaire unilingue dans la langue choisie. Pour les options : arabe, chinois, hébreu et polonais, l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé en plus du dictionnaire unilingue.
-
Pour l'option occitan-langue d'oc, l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé.
- L'usage de tout autre dictionnaire, de tout ouvrage de référence et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.
- VERSION ANGLAISE -
They were to hold hands and look at one another. Deeply, into each
other’s
eyes.
"It's not a
sitting," she said, "it's a standing. Why can’t I sit on his knee ?"
He
laughed. Everything she said amused or delighted him, everything about her
captivated him from her dark-red curly hair to her small white feet. The
painter's instructions were that he should look at her as if in love and
she at him as if enthralled. This was easy, this was to act
naturally.
"Don't be silly,
Harriet," said Simon Alpheton. "The very idea ! Have you ever seen a
painting by Rembrandt called The Jewish Bride ?"
They
hadn't. Simon described it to them as he began his preliminary sketch.
"It's a very tender painting, it expresses the protective love of the man
for his young submissive bride. They're obviously wealthy, they're very
richly dressed, but you can see that they're sensitive, thoughtful people
and they're in love."
"Like us.
Rich and in love. Do we look like them ?"
"Not in
the least, and I don't think you'd want to. Ideas of beauty have
changed."
"You
could call it 'The Red-haired Bride'."
"She's
not your bride. I am going to call it `Marc and Harriet in Orcadia Place'
- what else ? Now would you just stop talking for a bit, Marc ?"
The house
they stood in front of was described by those who knew about such things
as a Georgian cottage and built of the kind of red bricks usually called
mellow. But at this time of the year, midsummer, almost all the brickwork
was hidden under a dense drapery of Virginia creeper, its leaves green,
glossy and quivering in the light breeze. The whole surface of the house
seemed to shiver and rustle, a vertical sea of green ruffled into wavelets
by the wind. Ruth Rendell, A Sight
far Sore Eyes, 1999.
- VERSION ESPAGNOLE - Caminan lentamente
sobre un lecho de confeti y serpentinas, una noche estrellada de
septiembre, a lo largo de la desierta calle adomada con un techo de
guirnaldas, papeles de colores y farolillos rotos : última noche de Fiesta
Mayor (el confeti del adiós, el vals de las velas) en un barrio popular y
suburbano, las cuatro de la madrugada, todo ha terminado. [...] Cuelgan
las brillantes espirales de las serpentinas desde balcones y faroles cuya
luz amarillenta, más indiferente aún que las estrellas, cae en polvo
extenuado sobre la gruesa alfombra de confeti que ha puesto la calle como
un paisaje nevado. Una ligera brisa estremece el techo de papelitos y le
arranca un rumor fresco de cañaveral. La solitaria pareja es
extraña al paisaje como su mariera de vestir lo es entre sí : el joven
(pantalón tejano, zapatillas de basquet, niki negro con una arrogante rosa
de los vientos estampada en el pecho) rodea con el brazo la cintura de la
elegante muchacha (vestido rosa de falda acampanada, finos zapatos de
tacón alto, los hombros desnudos y la melena rubia y lacia) que apoya la
cabeza en su hombro mientras se alejan despacio, pisando con indolencia la
blanca espuma que cubre la calle, en dirección a un pálido fulgor que
asoma en la próxima esquina : un coche sport. Hay en el caminar de la
pareja el ritual solemne de las ceremonias nupciales, esa lentitud ideal
que nos es dado gozar en sueños. Se miran a los ojos. Están llegando al
automóvil, un "Floride" blanco. Súbitamente, un viento húmedo dobla la
esquina y va a su encuentro levantando nubes de confeti ; es el primer
viento del otoño, la bofetada lluviosa que anuncia el fin del verano.
Sorprendida, la joven pareja se suelta riendo y se cubre los ojos con las
manos. El remolino de confeti zumba bajo sus pies con renovado impetu,
despliega sus alas niveas y les envuelve por completo, ocultándoles
durante unos segundos : entonces ellos se buscan tanteando el vacío como
en el juego de la gallina ciega, ríen, se llaman, se abrazan, se sueltan y
funalmente se quedan esperando que esa confusión acabe, en una actitud
hierática, dándose mutuamente la espalda - perdidos por un breve instante
- extraviados en medio de la nube de copos blancos que gira en tomo a
ellos como un torbellino.
Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa
Barcelona, Seix Barral, 1967 (p.9-10).
- VERSION ALLEMANDE - Die Wucht der
Erinnerung traf ihn unvorbereitet. Er hatte nicht vergessen, daß dies ihr
erster Bahnhof gewesenwar, ihre erste gemeinsame Ankunft in einer fremden
Stadt. Natürlich hatte er das nicht vergessen. Aber er hatte nicht damit
gerechnet, daß es, wenn er hier stünde, sein würde, als sei überhaupt
keine Zeit verstrichen. Die grünen Eisentrâger und die roten Rohre. Die
Rundbogen. Das lichtdurchlässige Dach.
"Laß uns
nach Paris fahren!" hatte Florence beim ersten Frühstück in semer Küche
plötzlich gesagt, die Arme um das angezogene Bein geschlungen.
"Du
meinst..."
"Ja, jetzt. Jetzt gleich!"
Sie war
seine Schülerin gewesen, ein hübsches, meist ungekämmtes Mädchen, das
durch seine aufreizende Launenhaftigkeit allen den Kopf verdrehte. Von
einem Quartal auf das nâchste war sie dann ein As in Latein und Griechisch
geworden, und als er die freiwillige Hebäischklasse jenes Jahres zum
erstenmal betrat, saß sie in der ersten Reihe. Doch Gregorius wäre nicht
im Traum auf den Gedanken gekommen, daß das etwas mit ihm zu tun haben
könnte.
Es kam die
Maturitätsprüfung, und danach verging noch einmal ein Jahr, bevor sie sich
in der Cafeteria der Universitât begegneten und sitzen blieben, bis man
sie hinauswarf.
"Was bist du fur eine
Blindschleiche1" hatte sie gesagt, als sie ihm die Brille
abnahm. „Hast damals nichts gemerkt! Dabei bat jeder es gewusst!
Jeder !"
Richtig war, dachte
Gregorius, als er jetzt im Taxi zum Gare Montparnasse saß, daß er einer
war, der so etwas nicht bemerkte - einer, der sogar vor sich selbst so
unscheinbar war, daß er nicht daran glauben mochte, jemand könnte ihm -
ihm! - ein starkes Gefühl entgegenbringen. Doch bei Florence hatte
er damit recht behalten.
"Du hast nie wirklich
mich gemeint", hatte er am Ende ihrer fünfjährigen Elle zu ihr
gesagt.
Es waren die einzigen anklagenden Worte,
die er während der ganzen Zeit zu ihr gesagt hatte. Sie hatten gebrannt
wie Feuer, und es war gewesen, als zerfiele alles zu Asche.
Sie hatte zu Boden gesehen. Trotz allem hatte er auf Widerspruch
gehofft. Er war nicht gekommen. Pascal Mercier (Pseudonym von
Peter Bieri) :
Nachtzug nach Lissabon
1 die Blindschleiche
(« orvet » auf Französisch) ist eine schlangenartige Eidechse. Das Wort
kann sowohl auf das Reptil hinweisen als auch auf einen schlecht sehenden
Menschen.
- VERSION LATINE - UNE MORT VOLONTAIRE
L'auteur relate un événement dont il a été témoin dans le bourg de
Iulis, sur l'île grecque de Céos, où il accompagnait Sextus Pompeius,
proconsul en Asie de 24 à 26 après J.-C. : une femme de la haute société
locale, très âgée, ayant décidé de se donner la mort par le poison, a fait
demander à Sextus Pompeius de venir auprès d'elle pour assister à ses
derniers instants.
Venit itaque ad eam facundissimoque sermone, qui ore eius quasi e
beato quodam eloquentiae fonte manabat, ab incepto consilio diu nequicquam
reuocare conatus1, ad ultimurn propositum exsequi passus est. Quae,
nonagesimum annum transgressa cum summa et animi et corporis sinceritate,
lectulo, quantum dinoscere erat2, cotidiana consuetudine cultius strato
recubans et innixa cubito : « Tibi quidem, inquit, Sex. Pompei, dii, magis
quos relinquo quam quos peto, gratias referant, quod nec hortator uitae
meae nec mortis spectator esse fastidisti. Ceterum ipsa hilarem fortunae
uultum semper experta, ne auiditate lucis tristem intueri cogar, reliquias
spiritus mei prospero fine, duas filias et una3 nepotum gregem superstitem
relictura, permuto. » Cohortata deinde ad concordiam suos, distributo eis
patrimonio et cultu suo sacrisque domesticis maiori filiae traditis,
poculum in quo uenenum temperatum erat constanti dextera arripuit. Tum
defusis Mercurio delibamentis et inuocato numine eius, ut se placido
itinere in meliorem sedis infernae deduceret partem, cupido haustu
mortiferam traxit potionem ac sermone significans quasnam subinde partes
corporis sui rigor occuparet, cum iam uisceribus eum et cordi imminere
esset elocuta, filiarum manus ad supremum opprimendorum oculorum officium
aduocauit. Nostros autem, tametsi nouo spectaculo obstupefacti erant,
suffusos tamen lacrimis dimisit. VALÈRE MAXIME
1 Comprendre <eam>
reuocare conatus. Même chose dans la suite de la phrase :
<eam> ad ultimum propositum exsequi passus est.
2 Erat, accompagné de
l'infinitif, signifie « il était possible de ».
3 Adverbe. DE L'ÉTUDIANT
AU PROFESSEUR
CERTIFIÉ étudiant diplômé de
Licence
(dernière année du grade de
Licence)

PLC 1 «
étudiant-professeur »
à l’
Université et à l’
IUFM
(1
ère année d’IUFM)
----------
CAPES « théorique
»
(épreuves écrites
d’admissibilité + épreuves orales d’admission)

PLC 2 «
professeur-stagiaire »
à l’IUFM
(2
ème année d’IUFM, rémunérée)
----------
« certification
»
(portfolio individuel –
dossier de validation – dossier de compétences)
cf. «
http://www.lille.iufm.fr/article.php3?id_article=2924 »

première affectation
en Établissements Publics
Locaux d’Enseignement (EPLE)
(= collège ou lycée)
et
début de carrière
en qualité de
« professeur certifié de
Lettres Modernes »
- remerciements -
Tous nos remerciements au Président Christian Morzewski qui a encadré la
préparation depuis son origine à Arras, à Marie Rançon pour la composition
des annales ainsi qu’à Bernard Bouillon et Christophe Vasseur du service
de la communication pour la mise en ligne.
- informations arrêtées au 13 juillet 2007 -
|
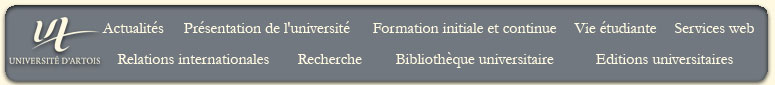

![]() Page d'accueil de l'U.F.R. de Lettres et Arts
Page d'accueil de l'U.F.R. de Lettres et Arts